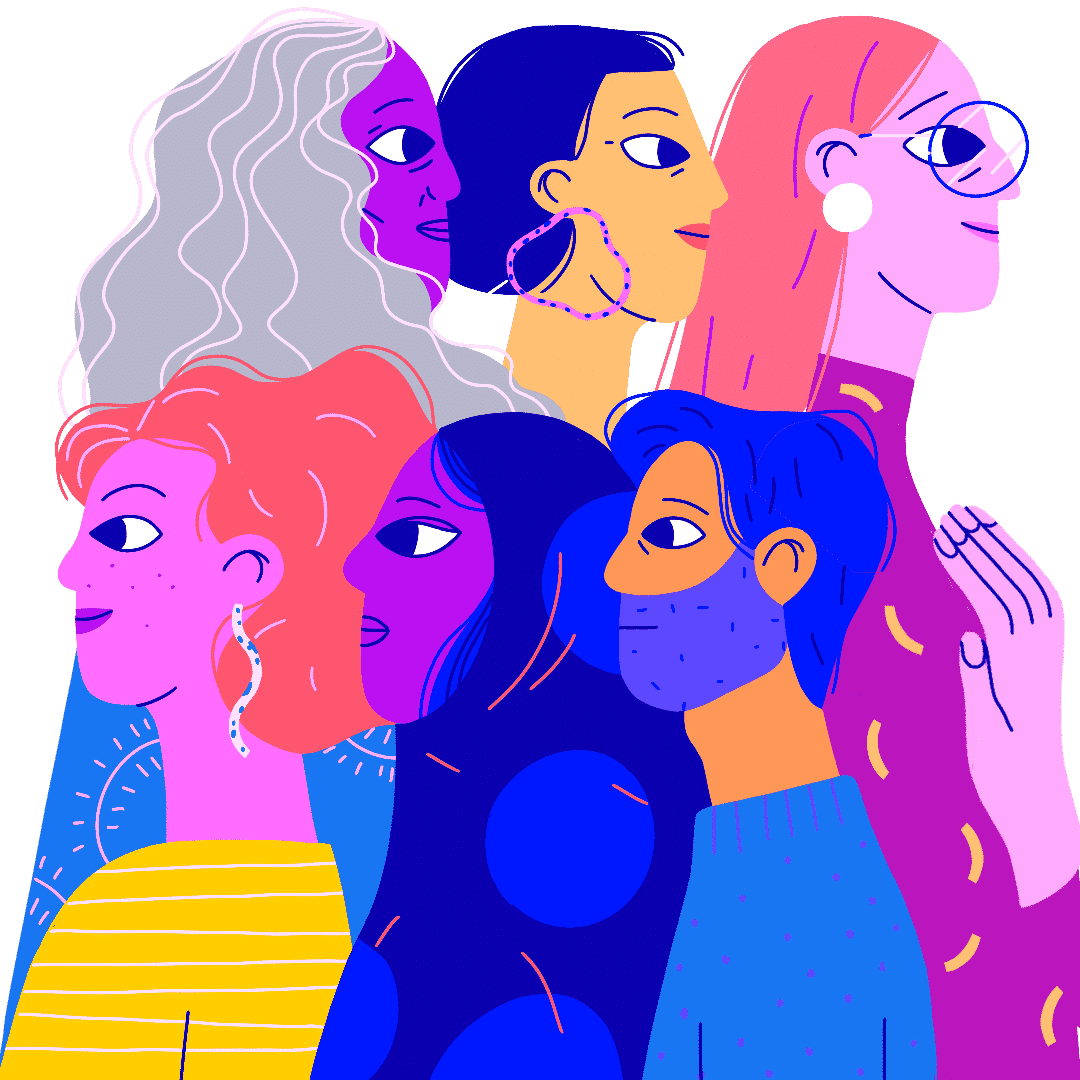Créer ensemble
des sociétés équitables
pendant et après
les conflits
Créer ensemble
des sociétés équitables
pendant et après
les conflits

Le risque est grand de voir un conflit réapparaître alors qu’un accord de paix a été conclu : dans la décennie suivant la signature d’un accord de paix, des affrontements armés se produisent dans près de la moitié des pays où a sévi une guerre civilen.
Si des femmes participent au processus de paix, la probabilité que la paix soit encore maintenue 15 ans après la signature d’un accord de paix augmente de 35 %.
Lorsqu’on n’attaque pas les problèmes à leur source, les crises se répètent. Instaurer l’état de droit, rétablir la justice sociale, participer à la transition vers des sociétés démocratiques sont donc des mesures importantes pour le maintien de la paix.
C’est pourquoi le ministère fédéral des Affaires étrangères soutient des projets dans ces domaines :
Laos
Égalité des sexes dans les comités locaux d’arbitrage
Partenaire du projet
Association for Development of Women and Legal Education (ADWLE)
© ADWLE
Au Laos, lorsqu’une paysanne revenant du marché hebdomadaire où elle a vendu poules et fruits prend le bac pour rentrer au village, et qu’elle ne peut s’accorder avec le batelier qui veut lui faire payer le passage de retour alors qu’elle dit l’avoir déjà payé à l’aller, ils s’adressent à un comité villageois d’arbitrage. Ces comités sont les éléments initiaux du système juridique laotien, et ce sont eux qui tranchent les litiges civils ou traitent les plaintes et les petits délits survenant dans les communautés villageoises. Les comités d’arbitrage revêtent une grande importance, car ils doivent avoir statué pour qu’affaires ou plaintes puissent être portées devant le système judiciaire.
Or, alors que les comités constituent ainsi la première instance du système juridique laotien, c’est à peine si leurs membres bénéficient d’une formation formelle de la part du gouvernement. Certains comités se fondent sur le droit coutumier ou traditionnel, qui peut fortement défavoriser les femmes, plutôt que sur la législation nationale, qui proscrit toute discrimination fondée sur le sexe. En outre, les femmes sont nettement sous-représentées dans les comités, le litige entre la paysanne et le batelier risquant ainsi d’être tranché de manière injuste et discriminatoire. Dans les affaires pénales portant sur des cas de violence sexuelle, il arrive aussi que les comités, méconnaissant la gravité du délit, s’estiment compétents alors que ce sont des juridictions pénales qui devraient être saisies. Cela peut aboutir à minimiser la gravité d’actes de violence sexuelle tels que les viols et à couvrir les faits.
C’est à cette carence que l’organisation « Association for Development of Women and Legal Education » (ADWLE) entend remédier. Elle mise à cet effet sur une double approche : en étroite collaboration avec l’administration judiciaire compétente, elle organise pour les membres des comités du district de Sangthong, dans la région de la capitale Vientiane, des formations juridiques prenant en compte la perspective du sexe. Il s’agit d’améliorer la formation et de sensibiliser les membres des comités à l’égalité entre hommes et femmes, aux droits des enfants, aux droits des femmes et à la traite des êtres humains. L’organisation mène parallèlement dans les communautés villageoises et les écoles un travail d’information destiné à sensibiliser les membres de la communauté à la violence sexuelle et sexiste, au droit familial, à l’égalité entre hommes et femmes et à l’accès aux garanties de l’état de droit.
Somalie
Réinsertion sociale d’anciennes membres de groupes extrémistes armés
Partenaire du projet
l’Organisation internationale pour les migrations (L’OIM)
© L’OIM
Malgré les progrès maintenant réalisés dans la stabilisation et la construction de l’État en Somalie, la situation reste précaire après des décennies de violence armée, d’insécurité, d’instabilité politique, de pauvreté, de division sociale, de dangers naturels et d’insuffisance de développement économique, et la violence reste à l’ordre du jour dans de vastes parties du pays.
Des groupes extrémistes armés continuent d’aviver le conflit, constituant la menace la plus immédiate pour une évolution pacifique en Somalie. Depuis 2015, l’Allemagne soutient le programme somalien de réinsertion d’anciens membres de groupes armés et de jeunes vulnérables, qui est mis en œuvre notamment avec l’aide de l’Organisation internationale pour les migrations.
Le programme vise à mettre en place des processus viables, fiables, transparents et internationalement reconnus permettant aux anciens membres de groupes extrémistes armés de se désengager, et à leur fournir un soutien pour leur réinsertion dans la société. Il réduit ainsi les germes de conflit et favorise la résilience sur le plan individuel et social.
Le programme tient aussi compte des risques particuliers qu’encourent les femmes et les filles auparavant associées à des groupes extrémistes, qui souvent sont des rescapées d’actes de violence sexuelle liés aux conflits. Il propose ainsi des programmes intégraux et sexo-spécifiques de réhabilitation et de réinsertion aidant les femmes à retourner en toute sécurité dans leur commune d’origine. Dans des centres de réhabilitation, des personnes auparavant associées à des groupes violents et extrémistes bénéficient d’amples prestations, notamment rémunérations mensuelles, assistance spirituelle religieuse, instruction de base et soutien pour l’acquisition de moyens de subsistance et la création de petites entreprises. En outre, les rescapées de violences sexuelles liées aux conflits peuvent accéder à des produits d’hygiène ainsi qu’à un traitement médical et à une aide psychosociale. L’OIM gère en Somalie deux centres de réhabilitation pour les femmes et collabore avec trois organisations féminines de la société civile. En 2019, le programme a fourni à 180 femmes une aide à la réinsertion sociale à Mogadiscio, Kismaayo et Baidoa.
Somalie
Avec Radio Daljir, les femmes et les jeunes filles font entendre leur voix
Partenaire du projet
Radio Daljir
© Radio Daljir
La situation des droits humains reste critique en Somalie après des décennies de guerre civile. La principale cause des violations des droits humains réside dans les continuels conflits armés dans certaines parties du pays, y compris guerres des clans et lutte anti-terrorisme. De plus, la milice islamique radicale terroriste Al-Shabaab continue de contrôler certaines zones du sud du pays, et ce sont particulièrement les enfants et les femmes qui souffrent de sa domination. En même temps, certaines instances étatiques et d’autres acteurs non étatiques sont également responsables de violations des droits humains. La violence sexuelle, le recrutement forcé d’enfants, les enlèvements, la torture et les assassinats illégaux sont largement répandus. La Somalie compte parmi les pays où le taux de mutilation génitale féminine est le plus élevé au monde ; selon les Nations Unies, le taux de femmes de 15 à 49 ans concernées est d’environ 98 pour cent. Près de la moitié des jeunes femmes de Somalie ont, selon les Nations Unies, été mariées avant l’âge de 18 ans. Le taux de femmes au parlement est de 24 pour cent.
La station locale Radio Daljir s’engage en faveur du développement régional et des droits humains. Elle coopère tant avec les défenseurs des droits humains qu’avec les autorités locales. Une de ses priorités est le thème de l’égalité entre hommes et femmes : la question de l’égalité et de l’équité entre les sexes fait l’objet de tables rondes, de talk-shows et de pièces radiophoniques. Il s’agit d’un large éventail de thèmes, depuis la lutte contre la violence sexuelle et sa prévention, la situation en matière d’éducation et d’emploi des femmes, jusqu’à la participation des femmes aux processus politiques. Des jeunes femmes peuvent devenir rédactrices de Radio Daljir grâce à des programmes de formation continue.
Entre janvier 2019 et mars 2020, Radio Daljir a, avec le soutien du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères, donné à des femmes et des filles du Galmudug la possibilité de procéder dans 40 émissions de radio, des assemblées communales, des sessions de formation et des interventions sur les médias sociaux à un échange de vues sur les questions de l’égalité des sexes. La sensibilité à ces thèmes a en même temps été renforcée au sein de la population.
© l’ambassade d’Allemagne en Kinshasa
République démocratique du Congo
Être une femme en République démocratique du Congo
En République démocratique du Congo, les femmes luttent pour l’égalité en matière de partage du pouvoir, de droits et d’accès aux ressources. L’indice d’inégalité de genre du Programme des Nations Unies pour le développement classe la République démocratique du Congo 156e sur un total de 189 pays. Dans l’est du pays en particulier, la participation à la résolution du conflit est un enjeu, de même que la protection contre les violences sexuelles et sexistes, qui ont connu une recrudescence massive ces dernières années et ont détruit des femmes, des familles ainsi que la cohésion sociale pour plusieurs générations.
La participation des femmes aux processus de paix est plus qu’une question de droits des femmes : lorsque les femmes contribuent à ces processus, les accords conclus tiennent plus longtemps, visent davantage le changement social par le biais de dispositions politiques et impliquent davantage les divers groupes de la société civile. La participation des femmes aux processus de paix et de sécurité est donc une nécessité politique dans ces domaines.
À l’occasion du 20e anniversaire de la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité, l’ambassade d’Allemagne à Kinshasa a invité le public à partager ses réflexions sur le sujet sous la forme d’un essai, d’un poème, d’une nouvelle ou d’un hommage.
Ruth Maketa, étudiante en médecine de Kinshasa, a convaincu le jury avec son poème « Être femme en RDC ». Elle y aborde les différents rôles joués par les femmes en République démocratique du Congo ainsi que ceux auxquels elles aspirent pour l’avenir.
Son poème a donc été désigné gagnant et a été publié en français, langue dans laquelle il a été rédigé, sur le site de l’ambassade d’Allemagne :
Copyright : Jonas Wresch
Etre femme en RDC
Depuis que, des horizons du Congo
Le soleil, de l'aurore, a éclos
La vie de la femme congolaise
N'a ainsi cessée d'être une vie d'une fonceuse.
Meilleur cocktail de la création
La nature lui a doté d'un cœur en diamant
Et le soleil a peint sa robe d'une peau en mosaïque
Elle épouse les éclats de la lune
Et se substitue à l'ébène
C'est la femme-beauté
De son sein, elle a offert au créateur un atelier
Où la création du peuple congolais a eu lieu
Elle l'a nourri de la sève de son cœur
Elle a gardé la flamme de sa vie afin qu'elle ne se meurt
C'est la femme-mère.
Cet être à tout faire
Celle qui fait fondre le fer
Celle qui cultive la terre
Celle qui, de ses larmes, éteint les terreurs
Sans jamais se plaindre
Et autant bénévole
Elle se plaît à jouer tous ses rôles
C'est la femme-au foyer
Réduite à la maternité, au plaisir sexuel
Restreinte à la lessive, aux casseroles
Elle se voit marginalisée, sans droit au mot
Jusqu'à ce jour par l'homme dans son désir macho
Elle reste dommage la femme-objet.
Rester bras croisés n'est pas son fort
D'elle dépend pour sa famille, survie et confort
Petit ou grand que ça soit son business
Elle y met abnégation et conscience
Ambition et détermination sont ses atouts
Rien ne l'arrête même la peur de son statut
C'est la femme d'affaires, celle qui peut tout.
Dans la détermination à diriger une entité
Elle se bat pour se faire une place dans la société
C'est la femme d'État
Celle qui se démarque, celle qui se bat.
Sans arriver à l'anéantir
Les coups de la vie font sa force
Entre deux cris, elle donne la vie
Entre deux larmes, elle transmet un sourire
Les coutumes ont cousu sa bouche
Mais par les battements de son cœur
Elle sait s'exprimer, elle est incoercible
C'est la femme invincible.
N'est ce pas là le meilleur cocktail de la création ?
Pour un Congo encore plus fort parmi les nations
Valorisons la femme congolaise
Elle est ce piédestal qui saura l'élever au rang des grands
Car la grandeur et elle font un.
Ruth Maketa